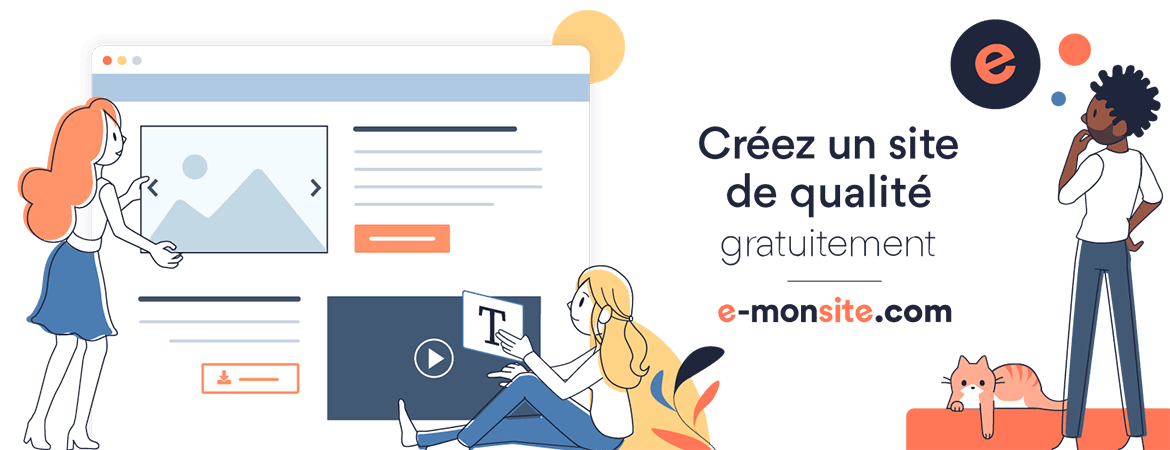Mercredi 9 septembre 2015, Michel
Thierry est un ami de longue date, avec lequel j’ai fait mes études d’ingénieur.
Thierry vient d’avoir cinquante ans. Ses cheveux très bruns, hérités de son origine espagnole, commencent à blanchir. Mais ses yeux sombres ont gardé leur éclat de jais. Sa femme – Véronique – encore désirable, montre tout de même les premiers signes de l’hiver qui s’annonce. Leurs deux aînés sont partis vivre leurs vies, leurs deux cadets ont encore quelques années d’étude devant eux, comme les miens.
Nous avons fait carrière dans la même entreprise, spécialisée en travaux souterrains. Nos affectations furent en général dans des lieux séparés, en France ou à l’étranger, mais nous avons aussi partagé quelques années aux mêmes endroits. Voici deux ans que nous sommes tous deux de retour à la maison mère et prévoyons d’y passer plusieurs années pour permettre à nos enfants respectifs de poursuivre leurs études plus sereinement. Nos épouses sont amies, ainsi que nos enfants, et nous partageons tous ensemble un dîner ou une randonnée de temps en temps.
Thierry est plutôt exubérant, surtout comparé à moi. Il hésite peu à montrer ses états d’âme alors que je conserve une nature discrète et que je cultive assez souvent le secret.
Malgré son passage dans la catégorie des quinquagénaires, il me montre les signes annonciateurs de la crise de la quarantaine. Il m’assure qu’il n’était pas prêt à élever ses quatre enfants quand ils sont arrivés dans sa vie. Selon lui, le temps a passé très vite à gérer le quotidien et c’est maintenant qu’il est mieux établi dans sa vie sociale et professionnelle qu’il aimerait fonder famille et s’occuper pleinement d’une progéniture. Il est clair pour lui que cette nouvelle ère serait accompagnée de la présence d’une femme jeune.
La corpulence de cet ami n’est plus très avantageuse mais son esprit et sa fortune lui donnent tout de même de sérieux moyens de séduction.
Un autre de ses fantasmes serait d’avoir engendré dans sa jeunesse des enfants dont il ignorerait l’existence et qui un jour viendraient sonner à sa porte pour se faire reconnaître.
Pour moi, cela présente tous les signes de la crise existentielle du quadragénaire. Il aimerait recommencer sa vie d’adulte, au lieu de se diriger lentement vers la vieillesse et les petits-enfants.
Il est vrai que notre travail intellectuel et nos moyens économiques peuvent nous le permettre : nous ne sommes pas encore usés physiquement, bien que le stress que l’on subit quotidiennement puisse aussi être une source d’épuisement prématuré.
Thierry a deux ans de plus que moi. J’ai sauté une classe en primaire et lui a redoublé son année de Mathématiques Spéciales, ce qui nous a permis de nous rencontrer lors de notre entrée en école d’ingénieur il y a vingt-neuf ans – en septembre 1986 – de faire un bout de chemin ensemble et ainsi de nous apprécier.
Lors de cette première année d’école, nous avons effectué notre stage ouvrier dans la même usine, sur une chaîne de montage, ce qui a renforcé les liens que nous avions noués au cours des premiers mois d’études. Nous étions préalablement devenus fanas de spéléologie et, venant du nord-ouest et nord-est de la France, avions découvert avec émerveillement la végétation et le climat méditerranéens lors de nos week-ends dans les massifs calcaires ardéchois. Pour le stage, nous avions initialement échoué dans nos démarches : nous espérions le faire près de Vallon-Pont-d’Arc, dans une usine de crème de marron ou autre conserverie ardéchoise mais le choix était limité et ces sociétés n’étaient pas intéressées – du moins pas pour les dates fixées. Mon père nous avait d’une certaine façon sauvé la mise en parlant à une de ses connaissances : une chaîne de montage ardennaise de cuisinières bois-charbon nous accueillerait pour nos quatre semaines de mise en situation dans la position d’ouvrier. Thierry allait dormir chez nous. Il avait une Peugeot 104 et s’occuperait de nous transporter tous deux à l’usine, située à moins de dix kilomètres de la maison. C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans les Ardennes en février 1987, devant le chef d’atelier qui nous a conduits sur nos chaînes respectives après un tour sommaire de l’entreprise : j’allais monter quatre-vingt-seize portes de poêle par jour pendant que Thierry allait poser et visser des couvercles de cuisinière sur une autre chaîne.
Le midi nous avions convenu de ne pas manger ensemble, de façon à nous immerger dans le monde ouvrier. Nous déposions nos gamelles le matin et les récupérions réchauffées au bain-marie pour la pause du déjeuner dans la petite salle des repas. Après avoir pris des couverts, un verre et une assiette, nous nous mettions à table. Le pain et l’eau étaient fournis. Le café aussi mais je n’en buvais pas à l’époque. Rien d’exceptionnel au lieu, rien de romantique. Cependant c’est là que j’ai rencontré Christine.
J’avais laissé mes camarades de chaîne s’asseoir en premier, car beaucoup avaient leurs habitudes et j’étais soucieux de ne pas les déranger. Je me suis assis à côté d’eux, sans personne en face de moi. C’est alors que je l’ai vue dans l’embrasure de la porte. Je me suis bêtement dit qu’elle était « pas mal », qu’elle devait venir de la comptabilité. Mais non : elle était, elle aussi, en bleu de travail. Elle resserrait sa tresse blonde en penchant la tête sur le côté. Puis elle s’en alla chercher un plateau et des couverts près de l’entrée.
Mes voisins avaient déjà attaqué leur repas : patates bouillies et viandes ou omelette, pâtes… du classique, roboratif. Ma mère nous avait préparé, à Thierry et moi, le même genre de plat. Je m’apprêtais à entamer mon déjeuner quand j’ai remarqué une silhouette qui me faisait face : la blonde était debout devant moi et me demandait si j’attendais quelqu’un. J’ai bredouillé un « non », surpris et un peu froid, comme pour lui faire croire que j’aurais préféré avoir une chaise vide en face de moi plutôt qu’elle. J’étais tétanisé. Elle m’a paru gênée, comme si elle regrettait déjà de s’être installée là. Prenant conscience de ma maladresse, j’ai essayé de redresser la barre en me présentant et en expliquant que je venais d’arriver sur la chaîne.
Je suis encore bouleversé quand je me remémore cet instant : un léger sourire est apparu sur son visage, l’illuminant, et son regard était doucement posé sur moi. J’ai toujours été fasciné par les femmes en tenues masculines – il faudrait peut-être un jour que je me fasse psychanalyser – en tenues inadaptées à leur morphologie mais qui paradoxalement les mettent en valeur : une chemise droite qui fait ressortir leur poitrine au lieu de l’épouser, une couleur unie et délavée qui fait éclater le teint de leur peau et la couleur de leurs yeux. Elle était en salopette bleue délavée, sa tresse blonde – plus précisément châtain clair – pesait sur son épaule gauche et ses yeux bleus me dévisageaient.
« Christine Rossi, fit-elle en me tendant la main. Moi, ça fait cinq ans que je travaille ici. Note, je ne compte pas y rester. »
En fait, la plupart des ouvriers « ne comptaient pas y rester ». Mais beaucoup étaient là depuis dix ans, vingt ans, voire trente-et-un ans pour une des femmes de la chaîne qui s’occupait de la visserie.